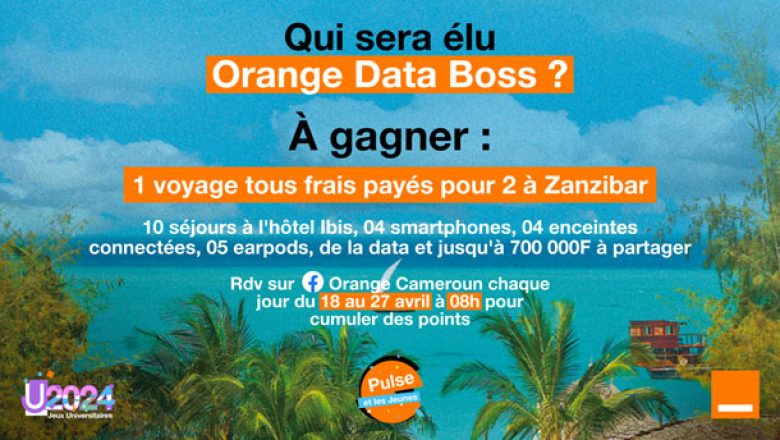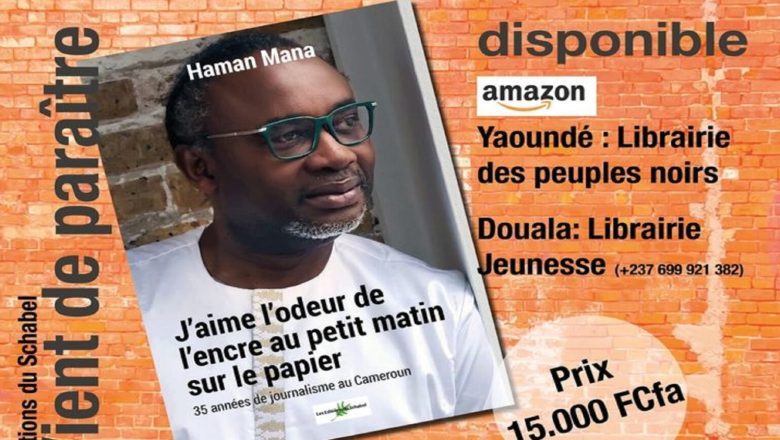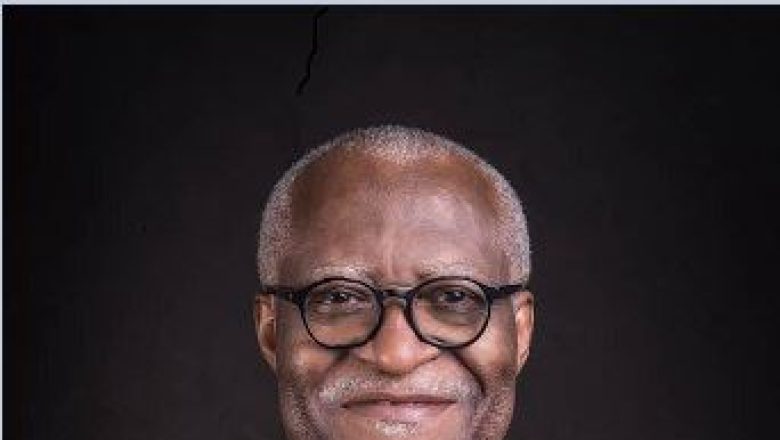EN CE MOMENT
26 avril 2024
26 avril 2024
26 avril 2024
Publié à 14h00
PARTENAIRE
14 avril 2024
14h09
14 avril 2024
14h09
15 avril 2024
Publié à 16h44
15 avril 2024
Publié à 16h42