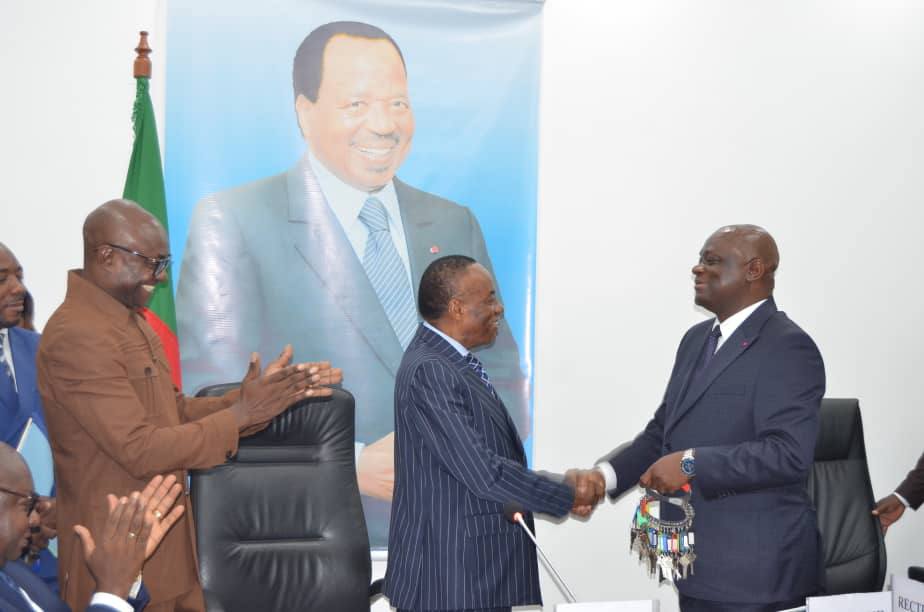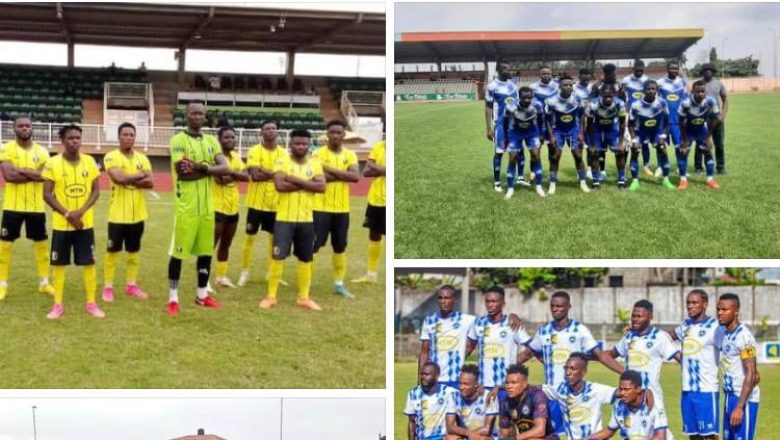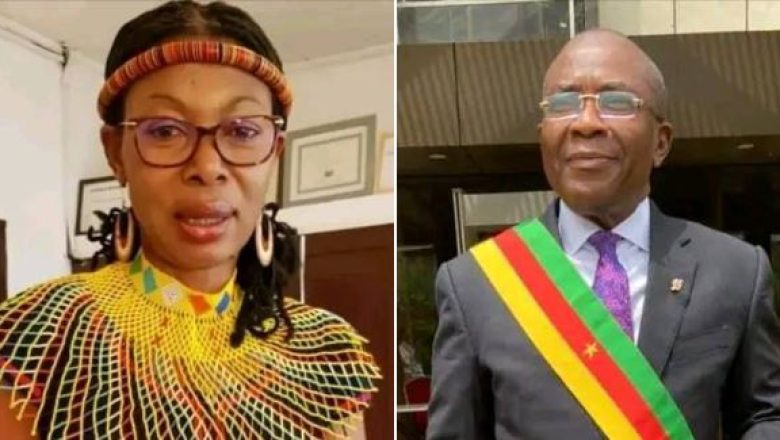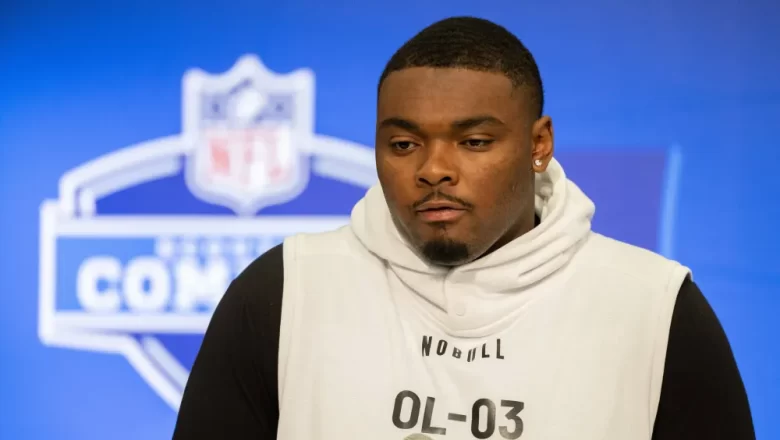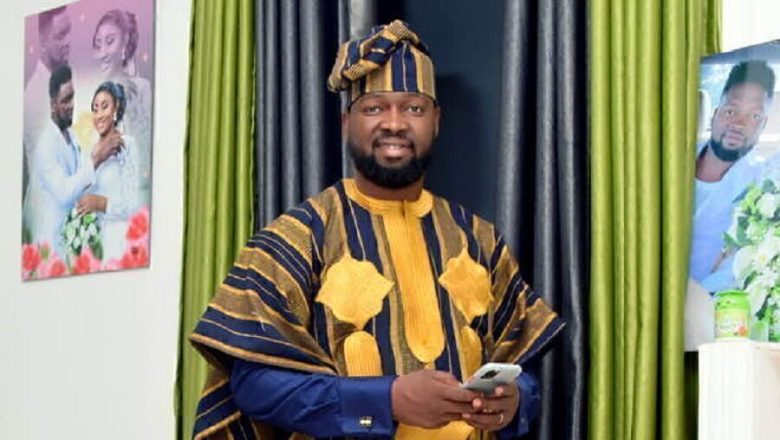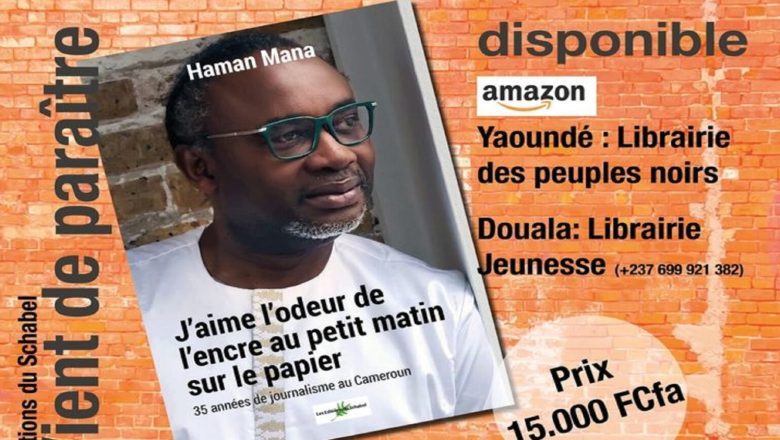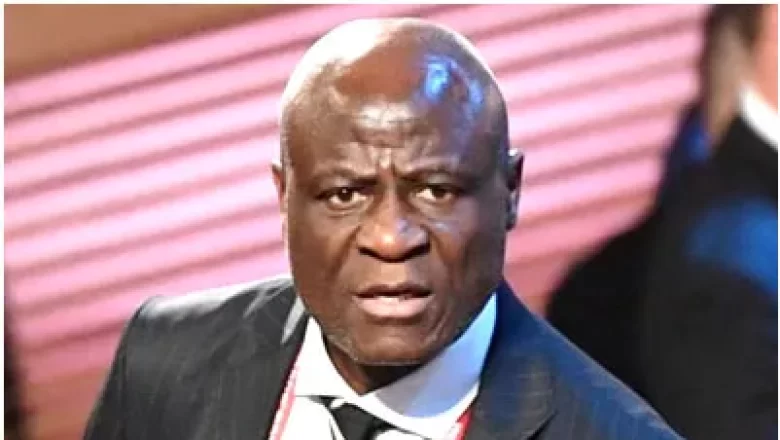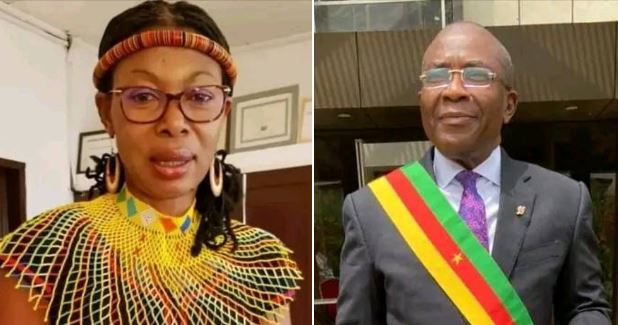EN CE MOMENT
4 mai 2024
4 mai 2024
Publié à 16h31
3 mai 2024
Publié à 14h44
2 mai 2024
Publié à 11h13
PARTENAIRE
30 avril 2024
Publié à 14h21