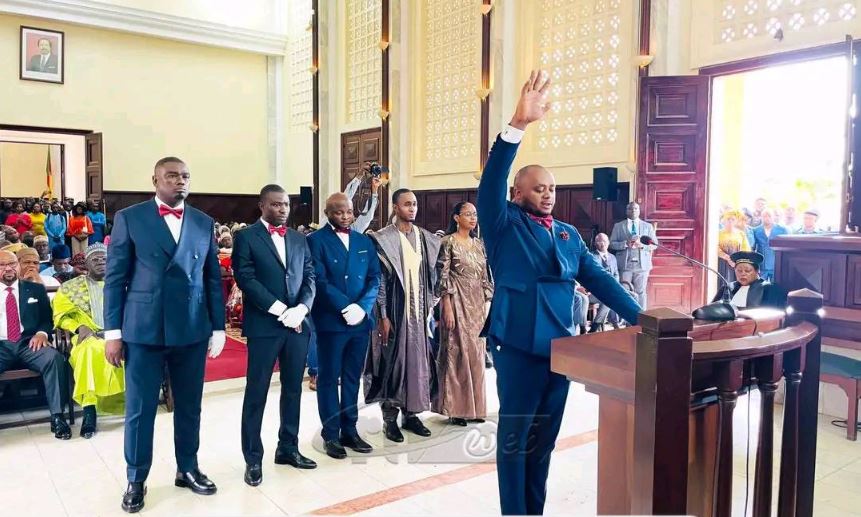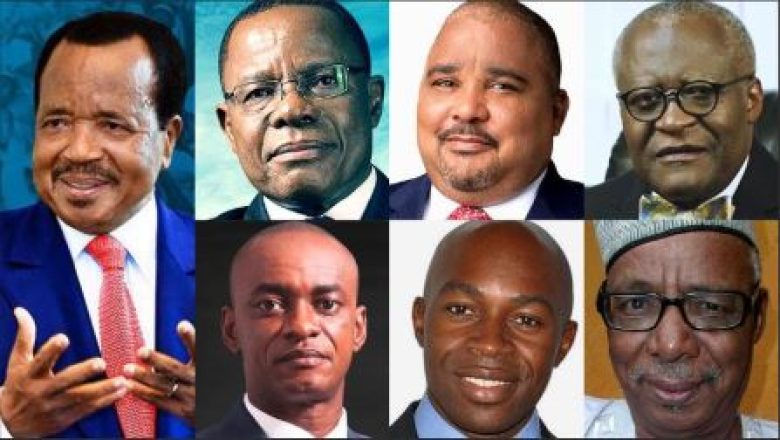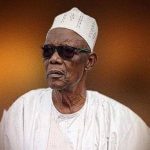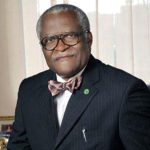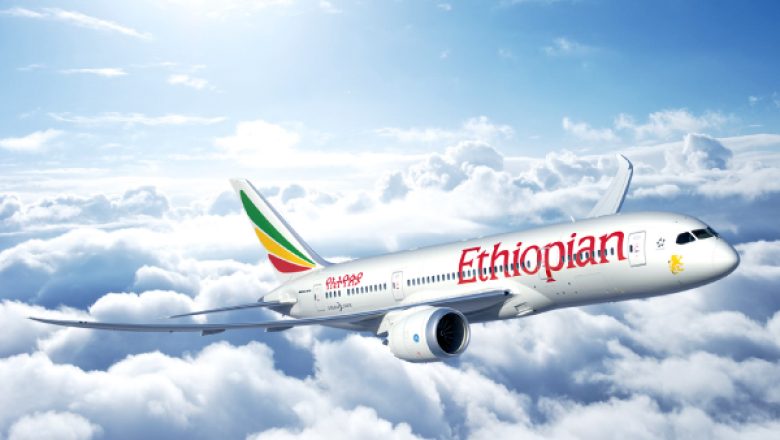FLASH INFO
Le Camerounais Georges ELOMBI nommé prochain président de AFREXIMBANK
EN CE MOMENT
27 juin 2025
Publié à 15h20
PARTENAIRE
SOCIETE
l'actualité société
CULTURE
L'actualité culturelle
SANTE
L'actualité Sanitaire
COMMUNIQUÉS OFFICIELS
NOUS SUIVRE
TOUTE L'ACTUALITE EN UN CLIC
NOTRE RESEAU DE SITES
Ailleurs en Afrique
AUTRES LIENS
- Parifoot cameroun - Quel est le meilleur bookmaker ?
- parissporitifs-mobile.com - Votre testeur d’app .