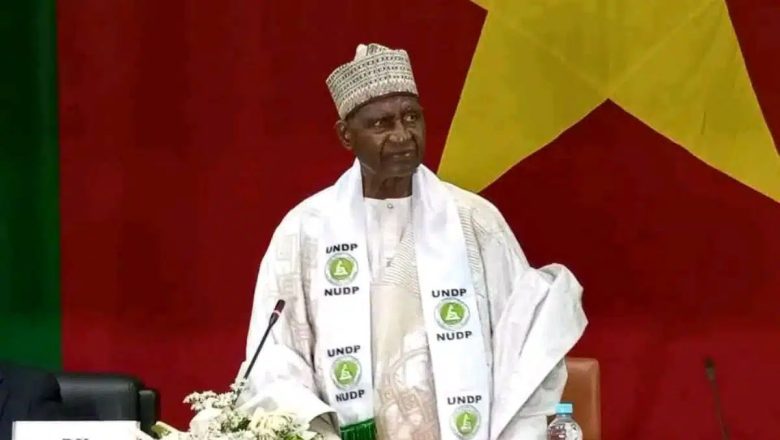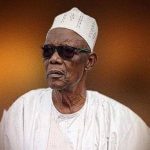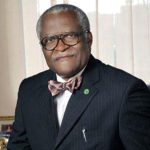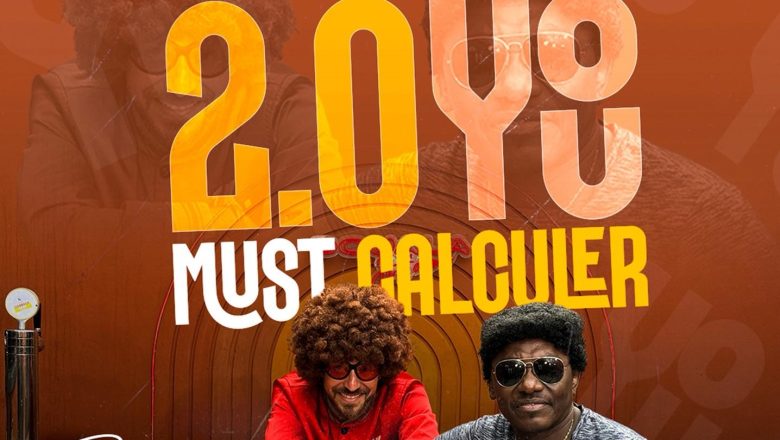EN CE MOMENT
30 juin 2025
30 juin 2025
Publié à 10h21
PARTENAIRE
 ORANGE CAMEROUN
ORANGE CAMEROUN
 ORANGE CAMEROUN
ORANGE CAMEROUN
30 juin 2025
Publié à 13h45
30 juin 2025
Publié à 13h22
SOCIETE
l'actualité société
CULTURE
L'actualité culturelle
SANTE
L'actualité Sanitaire
COMMUNIQUÉS OFFICIELS
NOUS SUIVRE
TOUTE L'ACTUALITE EN UN CLIC
NOTRE RESEAU DE SITES
Ailleurs en Afrique
AUTRES LIENS
- Parifoot cameroun - Quel est le meilleur bookmaker ?
- parissporitifs-mobile.com - Votre testeur d’app .