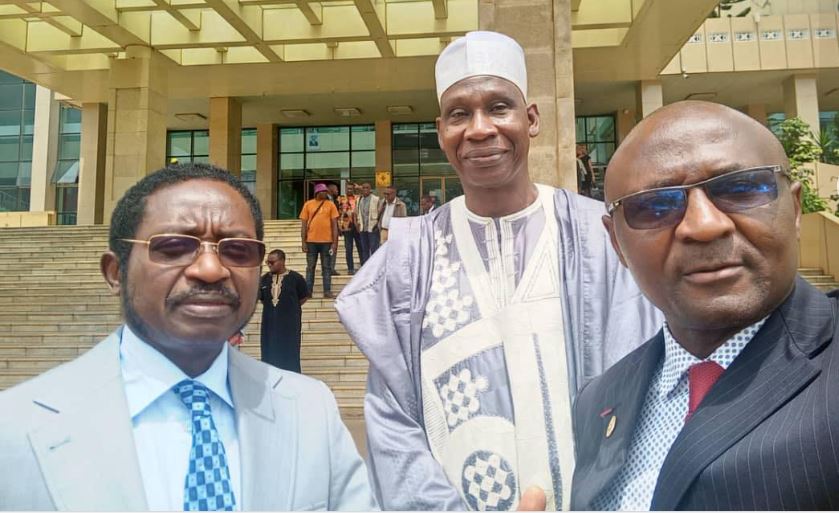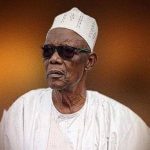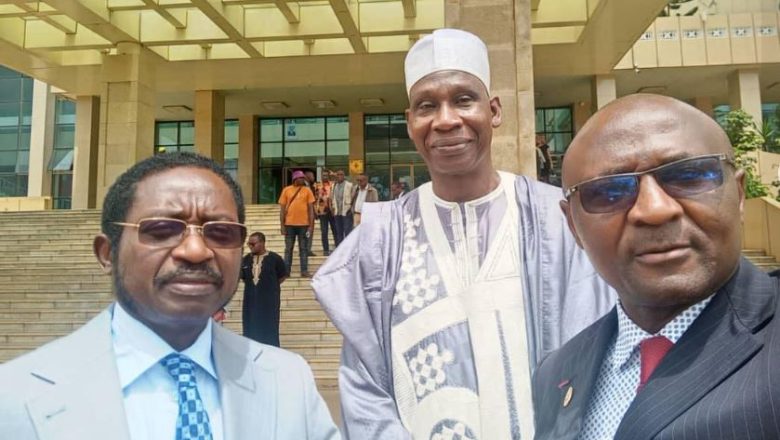EN CE MOMENT
3 juillet 2025
3 juillet 2025
3 juillet 2025
3 juillet 2025
Publié à 10h31
2 juillet 2025
Publié à 15h09
PARTENAIRE
 ORANGE CAMEROUN
ORANGE CAMEROUN
 ORANGE CAMEROUN
ORANGE CAMEROUN
SOCIETE
l'actualité société
CULTURE
L'actualité culturelle
SANTE
L'actualité Sanitaire
COMMUNIQUÉS OFFICIELS
NOUS SUIVRE
TOUTE L'ACTUALITE EN UN CLIC
NOTRE RESEAU DE SITES
Ailleurs en Afrique
AUTRES LIENS
- Parifoot cameroun - Quel est le meilleur bookmaker ?
- parissporitifs-mobile.com - Votre testeur d’app .