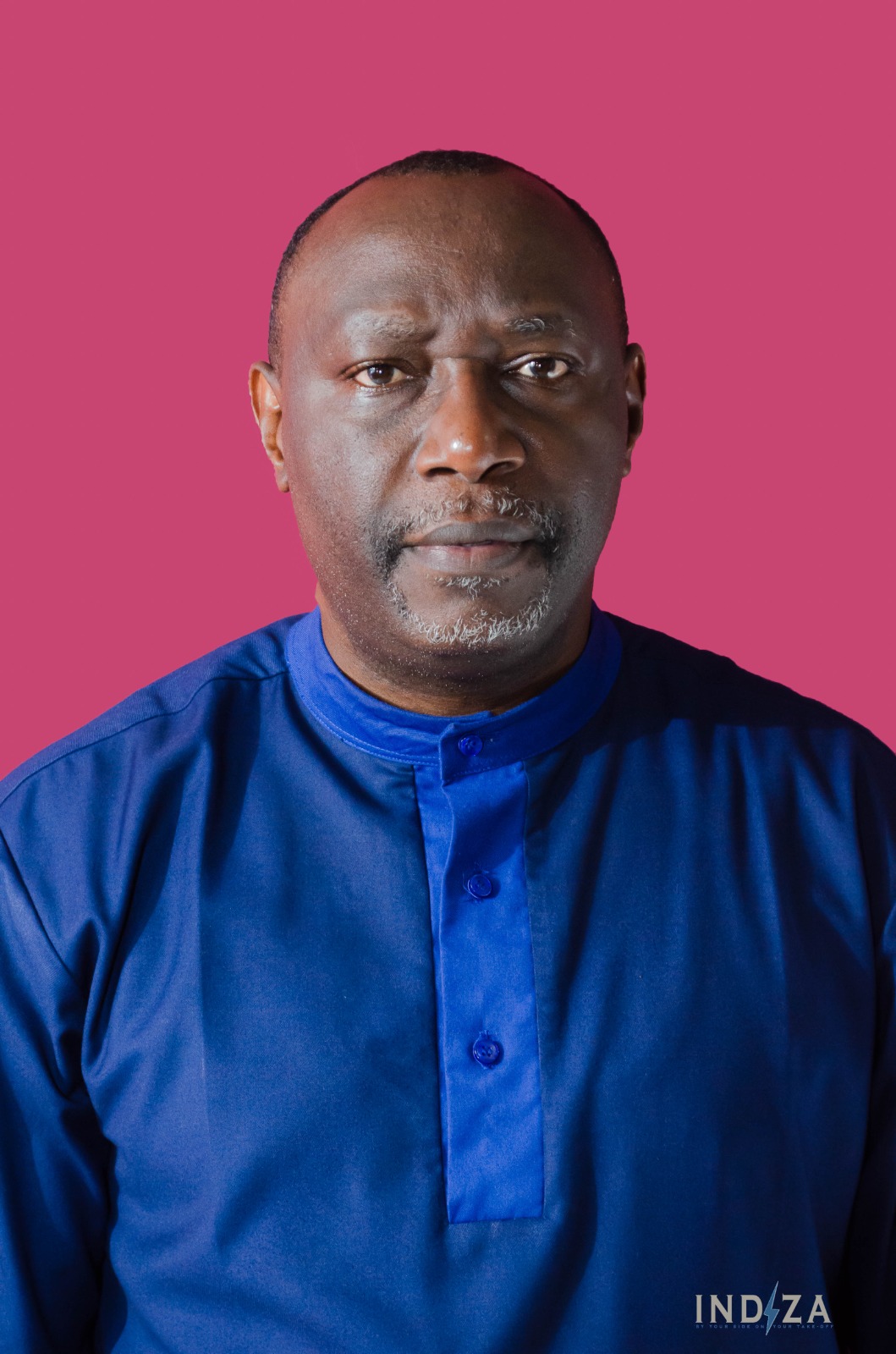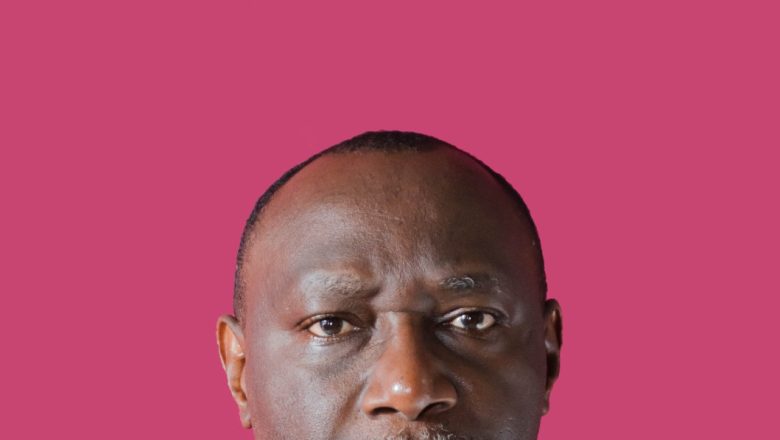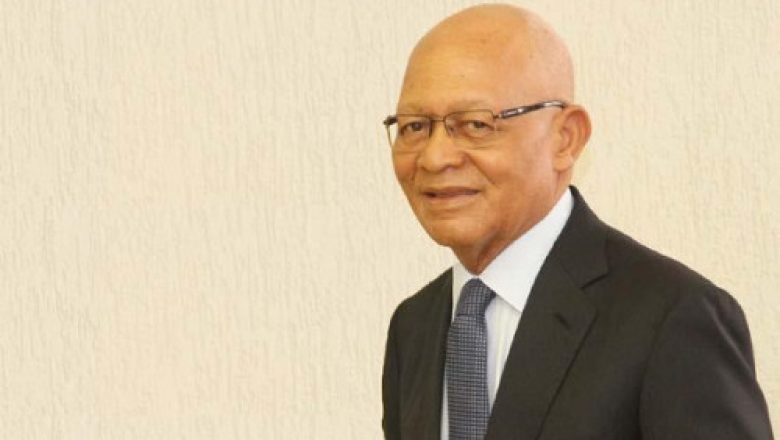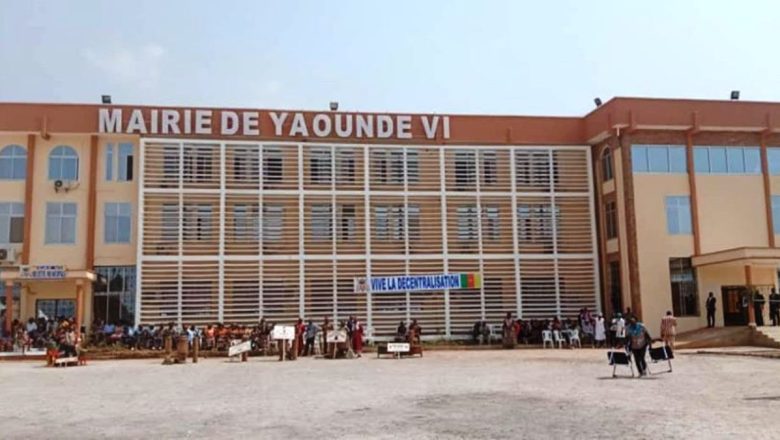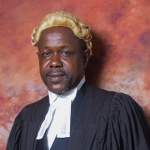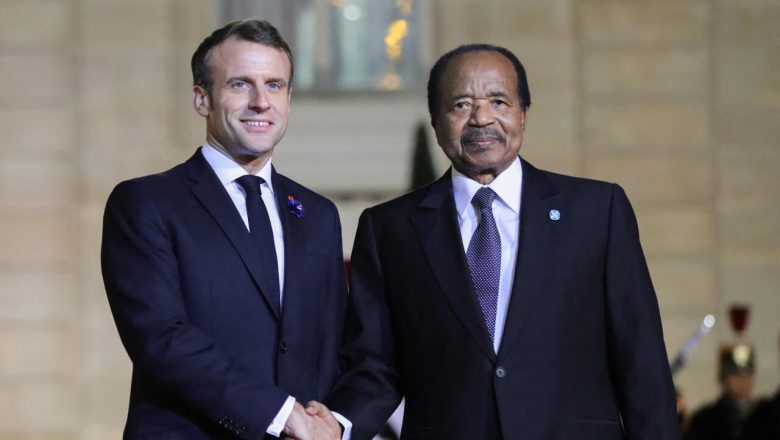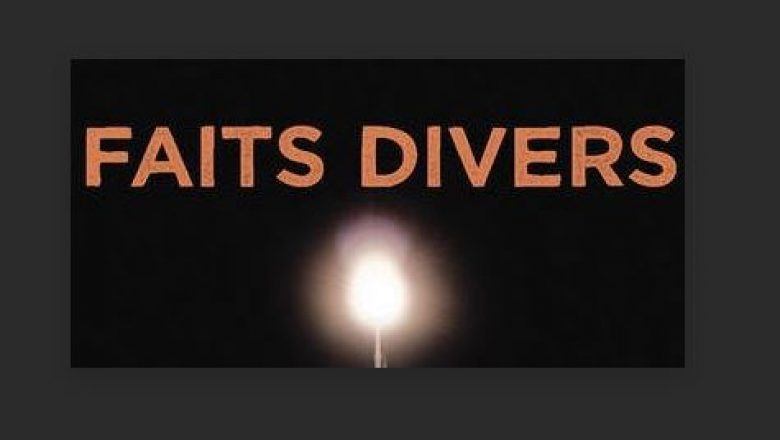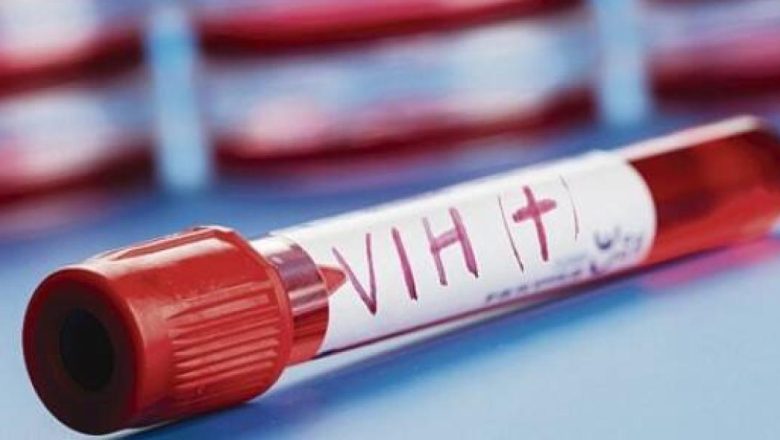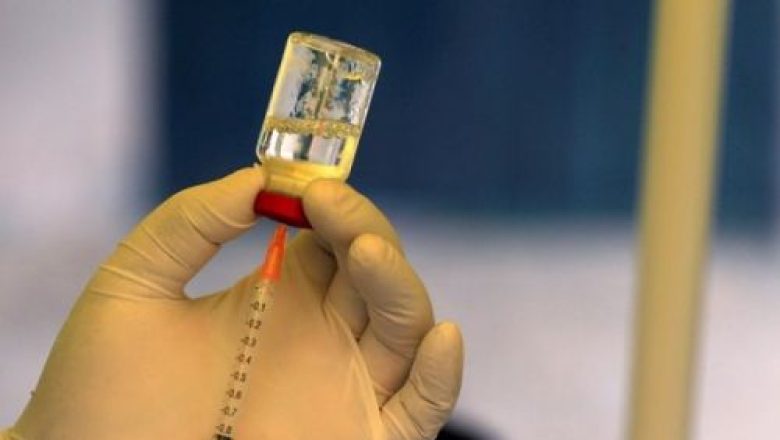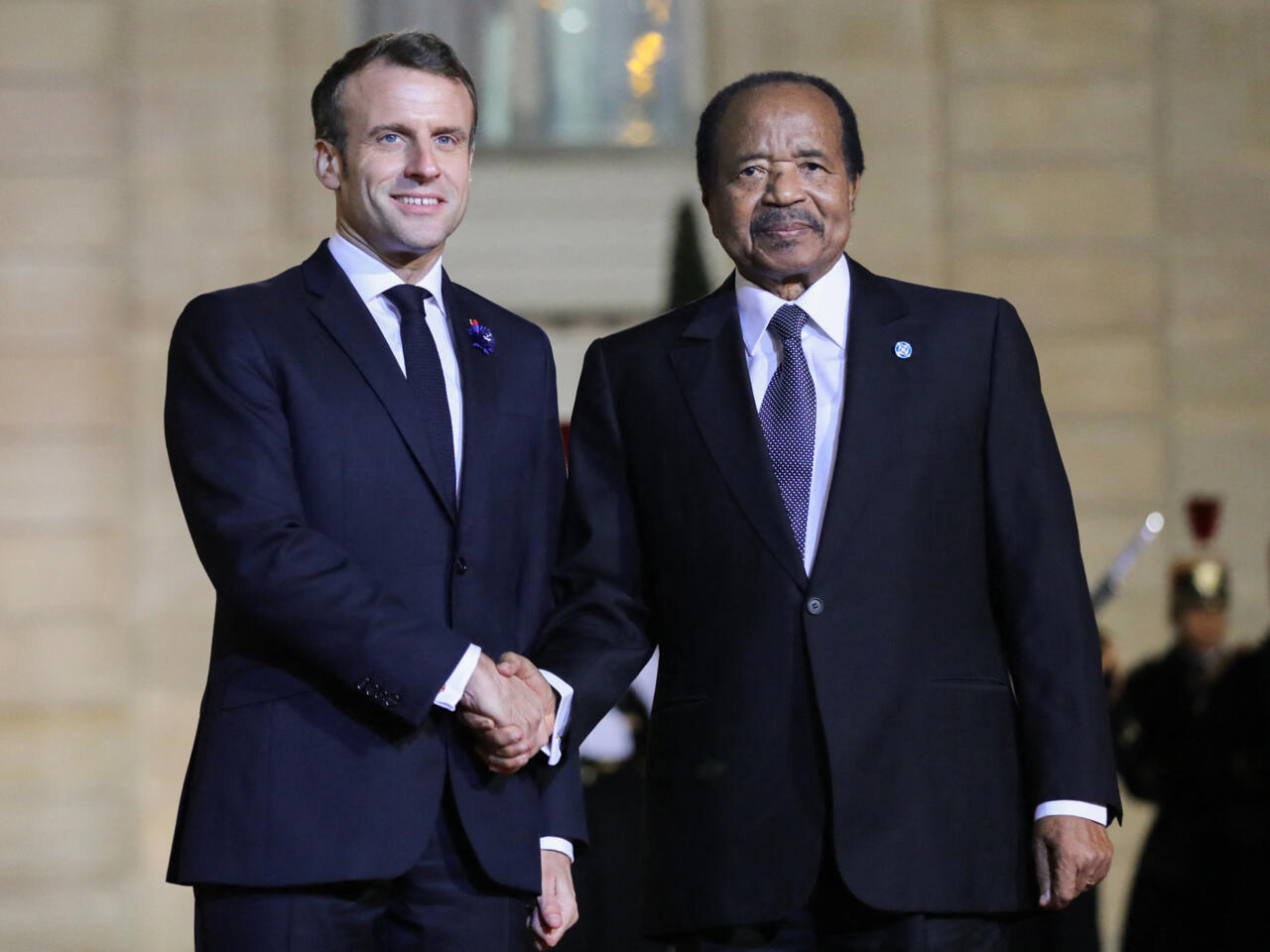EN CE MOMENT
26 juillet 2024
26 juillet 2024
26 juillet 2024
26 juillet 2024
Publié à 09h41
25 juillet 2024
Publié à 10h56
PARTENAIRE
24 juillet 2024
Publié à 09h44
Paul Biya et son épouse quitte Yaoundé ce 24 juillet 2024 pour Paris à…
12 juillet 2024
Publié à 15h33
11 juillet 2024
Publié à 16h14