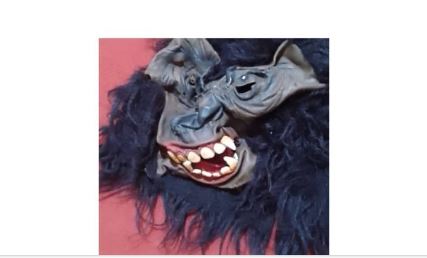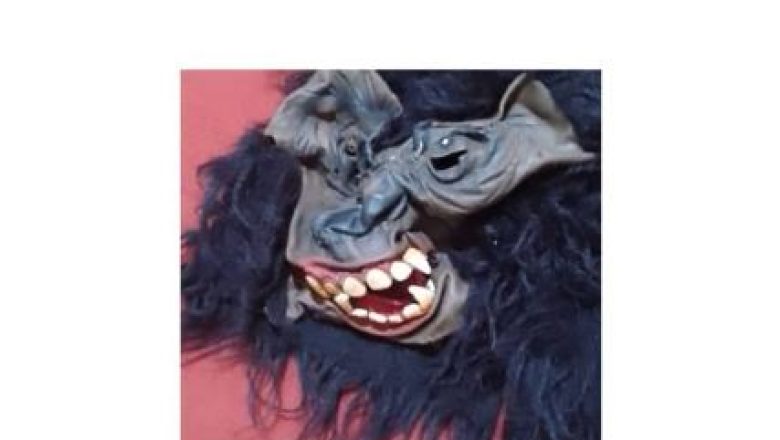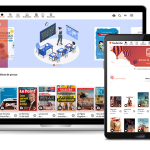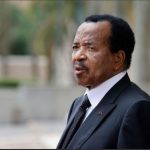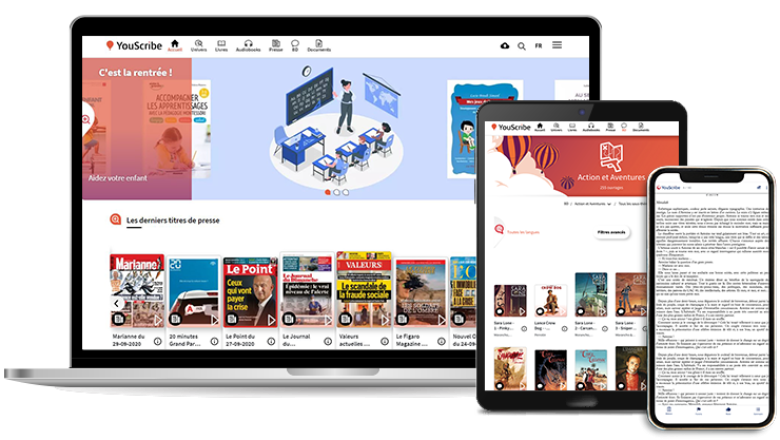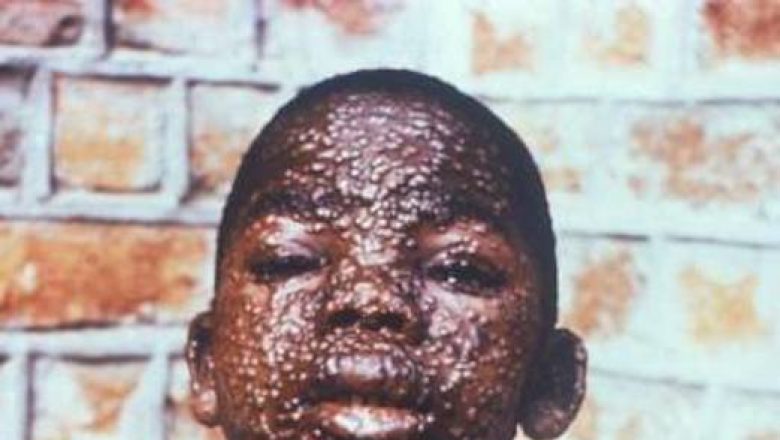EN CE MOMENT
21 octobre 2024
21 octobre 2024
21 octobre 2024
21 octobre 2024
21 octobre 2024
Publié à 16h15
21 octobre 2024
Publié à 08h54
PARTENAIRE
21 octobre 2024
Publié à 09h32
21 octobre 2024
Publié à 09h30
INTERNATIONAL
L'actualité Internationale
4 octobre 2024
Publié à 14h19
Une transaction estimée à plus de 260 millions d’euros. Alors que Société…
19 septembre 2024
Publié à 14h23
Le président gabonais évincé en août 2023 a signé une lettre ouverte dans…
SOCIETE
l'actualité société
CULTURE
L'actualité culturelle
SANTE
L'actualité Sanitaire
COMMUNIQUÉS OFFICIELS
NOUS SUIVRE
TOUTE L'ACTUALITE EN UN CLIC
NOTRE RESEAU DE SITES
Ailleurs en Afrique
AUTRES LIENS
- Parifoot cameroun - Quel est le meilleur bookmaker ?
- parissporitifs-mobile.com - Votre testeur d’app .